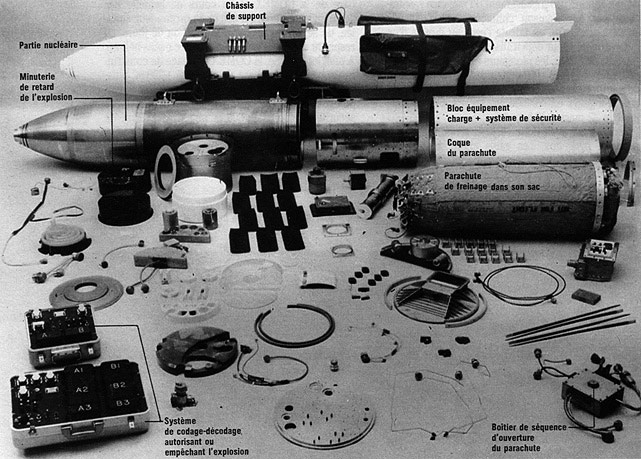Retour sommaire
Qui leur a donné la bombe
?
Malgré la complaisance de certains
pays nucléaires, malgré le commerce clandestin des
produits "sensibles" la prolifération des armes
atomiques est, Dieu merci, beaucoup plus lente que prévu.
Pourquoi ? Parce que, quoi qu'on dise, il n 'est pas si facile
que ça de faire la bombe ! Pourtant un nouveau venu est
sur le point d'y arriver.
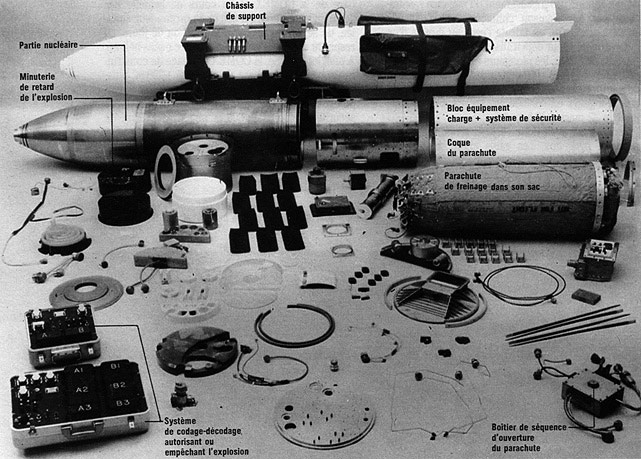
La fabrication d'une bombe nucléaire n'est pas à
la portée du premier venu. Il
n'y a pas moins de 1 800 composants dans cette bombe américaine
B-83 déployée depuis 1985. La sophistication d'un
tel engin est très supérieure à celle de
la bombe qui est actuellement à la portée des ingénieurs
pakistanais. Il n'en reste pas moins vrai qu'une bombe, même
rudimentaire, nécessite des investissements énormes
en matière grise et en haute technologie.
l1 y a une dizaine d'années, la CIA,
dans un bel élan de prospective alarmiste, prédisait
que le club très fermé des détenteurs de
l'arme nucléaire, qui ne comptait à l'époque
que cinq membres, pourrait bien en avoir une trentaine de plus
en l'an 2000. L'agence de renseignement américaine n'était
d'ailleurs pas la seule de cet avis. Divers rapports émanant
d'instituts de recherche prestigieux ou d'officines discrètes
n'ont cessé, et depuis plus longtemps encore, d'alerter
l'opinion sur l'imminence d'une prolifération des armes
atomiques.
Les années ont passé et, en 1988, le club ne compte
toujours, officiellement, que les cinq mêmes membres : les
Etats-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la
France et la Chine. On pourrait, il est vrai, ajouter Israël
et l'Afrique du Sud, qui possèdent certainement des engins
nucléaires, et même l'Inde, qui, si elle n'en a pas
encore fabriqué, est tout à fait en mesure de le
faire (en dehors des cinq "grands", c'est le seul pays
qui ait effectué un essai atomique).
Mais, même en comptant large, on est loin de la prolifération
galopante prophétisée il y a dix ans. Force est
de constater que, depuis la divulgation du rapport de la CIA,
aucun des pays "seuils", c'est-àdire de ceux
que l'on jugeait capables de se doter à brève échéance
de la bombe A, n'est devenu une puissance nucléaire. L'Argentine,
le Brésil, le Pakistan, l'Iran, l'Irak, la Corée
du Sud, etc., ne sont toujours pas parvenus à franchir
la porte.
Cela est d'autant plus étonnant que les barrières
qui devraient théoriquement protéger les technologies
clés du nucléaire militaire paraissent pour le moins
fragiles. On l'a encore vu, en janvier dernier, en Allemagne fédérale
: la firme Transnuklear, spécialisée dans le transport
des déchets atomiques, aurait, selon la presse d'outre-Rhin,
livré au Pakistan deux fûts d'uranium enrichi. A
peu près au même moment, on apprenait qu'une firme
belge - la Belgonucléaire, pour ne pas la nommer - aurait
construit, toujours au Pakistan, une unité pilote destinée
à produire du plutonium. N'y a-t-il pas là de quoi
accréditer la thèse de la prolifération et
donner, de surcroît, des sueurs froides s'il est vrai, comme
on le murmure, que le Pakistan a passé un accord avec la
Libye pour la mise au point d'une bombe commune ?

L'usine d'enrichissement de Kahuta,
au Pakistan
Tirer de ces faits la conclusion que le Pakistan
est en passe de devenir une puissance nucléaire, c'est
cependant aller un peu vite en besogne. Tant qu'il n'aura pas
procédé à une explosion expérimentale,
il demeurera un pays seuil. En revanche, les trafics, scandales
et manigances auxquels il parait mêlé démontrent
amplement qu'il n'est pas aussi facile qu'on le croit d'entrer
dans la classe des "grands" et qu'en particulier on
ne fabrique pas une bombe A comme on bricole un cocktail Molotov.
Pour bien prendre la mesure du problème
de la prolifération et comprendre pourquoi les candidats
à l'arme suprême ne peuvent parvenir à leurs
fins qu'à coups de combines et de complaisances, il nous
faut d'abord évoquer quelques questions d'ordre général.
En premier lieu, il faut savoir qu'il n'existe pas de marché
des armes nucléaires, comme il y a un marché des
armes conventionnelles. On ne peut pas acheter de bombes A toutes
faites ou en kit, avec mode d'emploi et garantie décennale.
Certes, ce n'est pas faute de clients, ni de négociants
prêts à commercialiser ce genre de produits. Rappelons
seulement l'histoire de cet ingénieur italien du nom de
Glauco Parte] qui, en 1982, proposa trois bombes A à quelques
acheteurs potentiels du MoyenOrient. Bien sûr, ces bombes
n'existaient que dans son imagination, et l'escroquerie fit long
feu. Mais elle eut le mérite de montrer qu'une telle offre
était susceptible d'intéresser pas mal de gens,
puisque au moins un groupe terroriste (rattaché à
l'OLP) et deux pays (l'Irak et la Syrie) se portèrent acquéreurs.
Le prix demandé par Partel était pourtant assez
exorbitant : 924 millions de dollars, soit 308 millions de dollars
la bombe ! A titre de comparaison un Pershing II vaut, charge
nucléaire comprise, environ 6 millions de dollars. Seulement
voilà, les fusées Pershing ne sont pas à
vendre.
S'il n'y a pas de marché, même noir, d'armes nucléaires
toutes faites, il existe par contre un marché clandestin
des matériaux et fournitures nécessaires à
leur fabrication. C'est précisément pour tenter
de mettre un terme à ces inquiétantes pratiques
qu'a été élaboré, en 1970, un traité
dit de «non-prolifération" (TNP). Malheureusement,
il n'a pas été ratifié par tout le monde
: l'Argentine, le Brésil, l'Inde, Israël, le Pakistan
et l'Afrique du Sud, c'est-à-dire la plupart des pays "seuils",
ont refusé de le signer, tout comme la France d'ailleurs,
qui a néanmoins déclaré qu'elle calquerait
sa conduite sur celle des pays signataires.
Qui a la bombe et
qui la veut?

La prolifération est moins rapide que prévu. Certains
pays jugés inquiétants dans les années 70
(Taiwan, Corée du Sud) semblent aujourd'hui en sommeil.
Reste qu'un nouveau venu, le Pakistan, est sur le point d'en posséder
une.
Aux termes dudit pacte, les Etats membres s'engagent
à ne transférer aucune technique, aucune matière
ni aucun équipement qui puisse permettre à un Etat
dépourvu d'armes nucléaires d'en fabriquer. Simple
dans sa formulation, ce traité l'est beaucoup moins dans
son application. En effet la filière civile, celle qui
conduit à la production d'électricité, a
bien des points communs avec la filière militaire, celle
qui mène à la bombe. Or, il ne saurait être
question de priver de centrales nucléaires les pays qui
en ont besoin. Comment alors empêcher que des matières,
des équipements ou même des installations complètes
ne soient détournés de leurs utilisations pacifiques
? Par un double contrôle : d'une part, celui de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui est chargée
d'inspecter tous les établissements nucléaires civils
à travers le monde ; d'autre part, celui des gouvernements,
qui doivent surveiller les exportations de produits dits "sensibles"
et tout particulièrement la circulation des éléments
nécessaires à la fabrication de charges explosives,
à savoir l'uranium 235 et le plutonium 239.
Pour faire une bombe A (laissons de côté les engins
thermonucléaires, beaucoup plus puissants certes, mais
aussi nettement plus complexes), il faut en effet soit de l'uranium
235, soit du plutonium. Où trouve-t-on ces deux matières
premières ?
Dans l'uranium naturel, il n'y a que 0,7 % d'U 235, le reste étant
constitué d'U 238 et de quelques traces d'U 234. Or, pour
avoir un uranium de qualité militaire, il faut qu'il contienne
environ 95 % de l'isotope 235. Il est donc indispensable d'"enrichir"
le produit naturel, c'est-à-dire d'augmenter sa teneur
en U 235. Pour cela, on a recours à divers procédés
difficiles et coûteux dits de "séparation isotopique".
Cet enrichissement n'est d'ailleurs pas réservé
uniquement aux applications militaires. Les réacteurs à
eau légère - la plupart de ceux qui composent le
parc nucléaire français - ont besoin pour fonctionner
d'un uranium enrichi à 3 ou 4 % ; certains réacteurs
de recherche utilisent un combustible enrichi à 20 % ;
et les réacteurs des sous-marins atomiques, en raison de
leur compacité, exigent un uranium enrichi à 97,3
%.
Actuellement, il n'existe pas moins de sept méthodes de
séparation isotopique, mais deux seulement sont exploitées
industriellement : la diffusion gazeuse et l'ultracentrifugation.
Dans le procédé de diffusion gazeuse, l'uranium
naturel est d'abord transformé en hexafluorure d'uranium
(UF6), un composé gazeux stable à température
moyenne. L'hexafluorure, comprimé, est introduit dans une
chambre de diffusion où il rencontre une paroi poreuse
qui, en vertu de la cinétique des gaz, laisse passer davantage
de molécules à base d'U 235 (molécules ayant
une masse plus faible) que de molécules contenant de l'U
238. De l'autre côté de la paroi, le gaz diffusé
se trouve "enrichi" d'environ 0,2 à 0,4%.
Si, partant de l'uranium naturel, on veut obtenir un uranium renfermant
95 % de l'isotope 235, il faut donc que l'hexafluorure traverse
environ 4 000 parois poreuses, lesquelles sont disposées
en série et constituent ce que l'on appelle une cascade
de diffusion gazeuse. Un nombre restreint de pays maîtrisent
cette technologie, parmi lesquels les EtatsUnis, l'URSS, la Grande-Bretagne,
la France (usine de Pierrelatte) et vraisemblablement la Chine.
L'ultracentrifugation, elle, utilise l'action de la force centrifuge
sur l'hexafluorure contenu dans un récipient tournant à
très grande vitesse. L'isotope le plus lourd, l'U 238,
gagne la périphérie du récipient, de sorte
que le gaz du centre se trouve enrichi en U 235. La RFA, la Hollande,
le Japon, l'Australie et le Pakistan possèdent ce type
d'installation.
A moins qu'il ne parvienne à se procurer directement de
l'uranium très enrichi - hypothèse peu plausible
-, un pays qui désire fabriquer une bombe à U 235
doit donc avant toute chose acquérir l'une ou l'autre de
ces filières.
En ce qui concerne la bombe au plutonium, la façon d'obtenir
la matière première est un peu plus compliquée,
l e plutonium, en effet, n'existe pas dans la nature ; il se forme
dans les réacteurs nucléaires quand les noyaux d'uranium
238 capturent des neutrons issus de la fission des noyaux d'uranium
235. Le plutonium est lui aussi constitué de plusieurs
isotopes, parmi lesquels le Pu 239, qui apparaît en premier
et convient le mieux aux applications militaires, et le Pu 240,
qui se développe si on laisse séjourner longtemps
l'uranium 238 dans le réacteur, mais qui est impropre à
la fabrication d'une bombe A. Un bon plutonium militaire doit
contenir moins de 7 % de Pu 240.
Pour obtenir du plutonium, il y a grosso modo deux méthodes.
La première consiste à utiliser un réacteur
fonctionnant à l'uranium naturel et modéré
au graphite ou à l'eau lourde. Grâce à l'action
de ces modérateurs, qui ralentissent considérablement
les neutrons nés de la réaction en chaîne,
ceux-ci peuvent être capturés par l'U 238. Ainsi
le plutonium se forme au coeur même du réacteur,
à l'intérieur du combustible.
La seconde méthode dérive plus ou moins de la première
: elle consiste à disposer autour du coeur d'un réacteur
fonctionnant à l'uranium enrichi une couche d'uranium naturel
ou appauvri (le reliquat de la séparation isotopique).
Le plutonium se forme, alors dans cette chappe bombardée
par les neutrons du coeur. C'est ce procédé qu'auraient
peut-être exploité (à long terme) les Irakiens
si l'aviation israélienne n'avait pas, à l'aube
du 7 juin 1981, détruit leur réacteur Osirak.
Après ces considérations techniques, revenons aux
mesures prises contre une éventuelle dissémination
des armes nucléaires. Bien évidemment, la vente
d'usines de séparation isotopique ou de réacteurs
plutonigènes est formellement interdite et fait l'objet
d'une surveillance très stricte. On peut dire que, depuis
la signature du traité de non-prolifération, aucune
installation de ce genre n'a été exportée
où que ce soit, la France ayant même annulé
les contrats qu'elle avait passés avec le Pakistan et la
Corée pour la livraison d'unités d'enrichissement.
Mais il n'en a pas été toujours ainsi auparavant.
De plus, s'il est relativement facile de contrôler la vente
d'une usine clés en main, il est beaucoup plus délicat
de surveiller le commerce des pièces détachées.
D'abord, parce que nombre d'entre elles, tels certains composants
électroniques ou certains ordinateurs, ne sont pas spécifiques
du domaine nucléaire. On peut donc prétendre les
acheter pour un tout autre usage, et ensuite les utiliser à
des fins interdites. Pour éviter autant que possible de
tels détournements, des listes ont été dressées,
régulièrement mises à jour, qui indiquent
les matériels et produits que les industriels ne peuvent
exporter sans l'accord exprès de leur gouvernement.
Mais établir des listes noires est une chose, les faire
respecter en est une autre. Les entreprises, en effet, rechignent
souvent à sacrifier de fructueux marchés et n'hésitent
pas à emprunter des circuits obliques pour acheminer leurs
marchandises illicites. D'autre part, les pays qui veulent coûte
que coûte se doter de l'arme atomique sont prêts à
tous les trafics et à tous les subterfuges pour parvenir
à leurs fins. Pour illustrer les difficultés et
les équivoques que rencontre la politique de non-prolifération,
nous allons prendre trois exemples : ceux d'Israël et de
l'Afrique du Sud, qui, selon toute probabilité, possèdent
aujourd'hui des armes nucléaires, et celui du Pakistan
qui, à l'heure actuelle, fait des pieds et des mains pour
arriver au même résultat.
Le programme nucléaire israélien
est né, peut-on dire, en même temps que l'Etat juif,
en 1948. Cernée de tous côtés par des pays
hostiles, la jeune nation a tout de suite compris qu'elle ne pourrait
garantir son existence qu'à condition de renforcer sa défense.
Et la défense suprême, c'était, bien entendu,
la possession de l'arme atomique. Aussi, dès cette époque,
les autorités de Tel Aviv envoyèrent-elles des géologues
dans le désert du Neguev pour y chercher de l'uranium,
et des étudiants dans les meilleures universités
mondiales pour y étudier la physique nucléaire.
En 1953, un premier accord de coopération est conclu avec
la France : il ne concerne que l'échange d'informations
sur le traitement des minerais d'uranium et les techniques de
production d'eau lourde (les physiciens israéliens de l'institut
Weizmann ont mis au point un procédé de fabrication
de l'eau lourde particulièrement bon marché).
C'est en 1956, à la suite de l'expédition avortée
de Suez, que le gouvernement français décide d'aider
Israël à installer un réacteur aux confins
du Neguev, à Dimona. Et pas n'importe quel réacteur,
mais une pile à uranium naturel et à eau lourde,
productrice de plutonium ! Pour camoufler l'opération,
le Mossad - les services secrets israéliens - laisse entendre
qu'il s'agit d'une usine textile. La CIA, cependant, ne tarde
pas à découvrir le pot aux roses, et les Etats-Unis
somment Tel Aviv de s'expliquer. Pour rassurer Washington, les
Israéliens prétendent qu'ils construisent un petit
réacteur de recherche, et ils invitent les experts américains
à venir inspecter l'installation dès que celle-ci
sera achevée.
ISRAËL, MEMBRE OFFICIEUX
DU "CLUB"

Le réacteur de Dimona fournit aux israéliens du
plutonium militaire.
Le réacteur "diverge" (entre
en fonctionnement) en décembre 1962. Il n'est plus possible
désormais de différer la visite des experts de l'Atomic
Energy Commission. Mais comment faire pour que ces derniers ne
découvrent pas la véritable nature ni la puissance
réelle de la prétendue pile expérimentale
? Pour mystifier leurs hôtes, les savants israéliens
ourdissent alors la plus belle opération d'intoxication
qui ait jamais été montée dans le monde nucléaire.
La voici telle que la décrit Pierre Péan dans un
livre remarquablement informé, Les Deux Bombes (
Editions Fayard, 1982) :
« A partir de plans fournis par le CEA (Commissariat à
l'énergie atomique, l'organisme français qui a coopéré
de bout en bout à l'édification de Dimona), ils
étudient un projet de réacteur de recherche non
plutonigène, ne fonctionnant pas à l'eau lourde,
mais qui soit cohérent avec le vrai réacteur. Et
ils créent, à partir de ce projet en trompe l'il,
un décor à l'intérieur du réacteur.
»
Le clou de cette opération est une fausse salle des commandes
de 80 m2 où viendront travailler les Américains.
Les instruments sont branchés sur un simulateur capable
de reproduire l'ensemble des phénomènes physiques
qui se déroulent dans une pile de recherche à énergie
nulle. Derrière le simulateur, mais bien caché,
est installé un ensemble de calcul où sont enregistrées
sous forme de modèles mathématiques tous les paramètres
caractérisant le fonctionnement de la pile expérimentale
non plutonigène que les experts américains doivent
recomposer à partir de leurs calculs. Ces calculateurs
ont évidemment digéré toutes les lois mécaniques,
électriques, thermodynamiques et neutroniques qui régissent
le fonctionnement de la fausse centrale de Dimona. Pendant toute
la durée de la simulation, plusieurs ingénieurs
se tiendront dans une salle cachée afin de superviser l'exercice...
»
Le plus beau, c'est que ça marche ! Les Américains,
chaleureusement reçus, royalement traités, n'y voient
que du feu. Ils passent une semaine à Dimona, prennent
des quantités de notes, et repartent convaincus qu'ils
ont inspecté un innocent réacteur de recherche.
Il s'agit pourtant bel et bien d'une redoutable machine à
fabriquer du plutonium. Au moins une dizaine de kilos par an,
de quoi confectionner une bombe A plus puissante que celle d'Hiroshima.
Mais ce plutonium, il faut l'extraire du combustible irradié,
c'est-à-dire le séparer de l'uranium au sein duquel
il s'est formé. Opération complexe et, de surcroît,
dangereuse, car tout ce qui sort d'un réacteur est très
fortement radioactif. Cette séparation ne peut être
réalisée que dans une installation très spécialisée
et grâce à des techniques très élaborées.
C'est encore la France qui aidera les Israéliens à
construire leur usine d'extraction de plutonium et qui les informera
sur la méthode à suivre. Cette usine, croit-on,
est devenue opérationnelle en 1965, et, dès l'année
suivante, les Israéliens auraient réussi à
fabriquer leur première bombe.
Ont-ils procédé à des essais ? La question
est très controversée. Selon certaines sources,
ils auraient effectué un test sur le polygone de Reggane,
au Sahara, là où les Français avaient expérimenté
leur première bombe A. Cette hypothèse paraît
pour le moins douteuse. En revanche, la version selon laquelle
ils auraient essayé leurs engins en pleine mer, au large
de l'Afrique du Sud, sur des pontons ancrés à l'écart
des routes maritimes, semble a priori plus crédible. En
effet, dès 1965, une coopération sur le plan nucléaire,
dont nous reparlerons, s'était engagée entre Tel
Aviv et Prétoria. D'autre part, à plusieurs reprises,
vers la fin des années 70, les appareils de mesure américains
ont enregistré des "événements"
suspects dans la région. Enfin, d'après une troisième
version, évoquée récemment par la presse
arabe, ces essais auraient eu lieu sur le continent Antarctique,
avec l'accord de la Norvège et de l'Afrique du Sud. Mais,
répétons-le, toutes ces assertions sont à
prendre avec la plus grande circonspection. En particulier, on
voit mal comment une explosion sur le continent Antarctique aurait
pu échapper aux multiples équipes scientifiques
qui sont installées en permanence sur ce territoire.
En septembre 1986, un technicien israélien révélait
aux journalistes anglais du Sunday Times que le réacteur
de Dimona produisait annuellement une quarantaine de kilos de
plutonium et que son pays possédait entre 100 et 200 bombes
A, suffisamment miniaturisées pour tenir dans l'ogive d'un
missile. Affabulait-il ? En tout cas, ses indiscrétions
lui valurent d'être enlevé à Rome par les
agents du Mossad et d'être traduit en justice, deux semaines
plus tard, à Jérusalem. Ce qui est certain, c'est
que les Israéliens signèrent, dans les années
60, un contrat de coopération avec la firme Marcel Dassault
pour l'étude de missiles sol-sol à deux étages
et à combustible solide, capables d'atteindre des cibles
situées à 500 km (Le Caire ? Bagdad ? Damas ?).
Depuis lors, ces engins, baptisés "Jéricho",
auraient vu leur portée passer à 1200 km.
Deux affaires en rapport avec la bombe israélienne montrent
combien il est difficile de contrôler les détournements
de matériaux "sensibles" quand on a affaire à
un Etat prêt à employer tous les moyens pour se les
procurer.
La première affaire est celle du Scheersberg. Pour
faire fonctionner le réacteur de Dimona, les Israéliens
ont besoin chaque année d'environ 24 tonnes d'uranium naturel.
Les phosphates uranifères du Neguev leur en fournissent
quelque 10 tonnes, et le reste est importé d'Afrique du
Sud et de France. Mais après l'embargo décidé
en 1967 par le général de Gaulle, il leur faut trouver
d'autres sources d'approvisionnement. Vers qui se tourner? L'URSS
et la Chine refuseront, c'est certain. Les Etats-Unis accepteront
peut-être, mais exigeront un nouveau contrôle. Le
Gabon, la République centrafricaine et le Niger entretiennent
des relations plus ou moins houleuses avec la France, mais respecteront
sans doute l'embargo. Restent le Canada et éventuellement
le Brésil. Mais, en attendant, il faut se débrouiller.
Les services secrets israéliens apprennent un jour que
560 fûts d'oxyde-d'uranium sont stockés à
Anvers. Ils viennent du Zaïre et sont la propriété
de la Société générale des minerais.
A l'automne 1968, les fûts sont achetés par une société
allemande et embarqués à bord du Scheersberg,
un petit cargo battant pavillon libérien. Ils doivent
être transportés à Gènes, où
l'uranium sera traité par une entre prise locale, la SAICA.
Tout est en règle : Euratom, qui veille jalousement à
ce qu'aucun produit nucléaire ne quitte la Communauté
européenne, a donné son accord. Mais les fûts
n'arriveront jamais à Gènes...
On apprendra la vérité beaucoup plus tard. La société
allemande qui avait acheté l'uranium était en fait
une société paravent, qui se déclarera en
faillite peu de temps après la transaction. La compagnie
libérienne propriétaire du Scheersberg n'était
ni plus ni moins qu'une succursale du Mossad. Quant aux 560 fûts,
ils avaient été transférés de nuit,
quelque part entre Chypre et la Turquie, à bord d'un navire
israélien. Deux cents tonnes d'oxyde d'uranium étaient
ainsi tombées aux mains des Israéliens, de quoi
alimenter le réacteur de Dimona pendant huit années
!
L'autre affaire met en cause la NUMEC (Nuclear Materials and Equipment
Corporation), une firme américaine installée à
Apollo en Pennsylvanie, et son président Zaiman Shapiro.
La NUMEC fabrique et vend des matériaux fissiles pour des
usages pacifiques et militaires. En particulier, c'est elle qui
fournit à la marine américaine le combustible utilisé
par les sous-marins nucléaires, c'est-à-dire de
l'uranium très fortement enrichi. Or, à l'occasion
d'une inspection, en 1965, l'ACE (Atomic Energy Commission) constate
la disparition de plus de 200 livres d'uranium enrichi (on avança
même le chiffre de 572 livres). Une enquête menée
conjointement par la Commission, le FBI et la CIA révélera
que, de 1957 à 1965, Shapiro avait couvert, sinon organisé,
plusieurs détournements du précieux métal
au profit d'Israël.
Ce trafic, toutefois, soulève une question : pourquoi les
Israéliens avaient-ils besoin d'uranium enrichi puisque
Dimona était en mesure de leur procurer suffisamment de
plutonium pour faire leurs bombes A ? Trois réponses sont
possibles. Ou bien les savants israéliens voulaient, parallèlement
à la bombe au plutonium, acquérir la technique de
la bombe à uranium 235. Ou bien ils désiraient mettre
au point une bombe mixte, faite d'un mélange de plutonium
et d'uranium enrichi, procédé couramment utilisé
pour la fabrication des armes nucléaires. Ou bien, enfin,
ils projetaient dès cette époque de se lancer dans
l'étude de la bombe thermonucléaire (il faut en
effet une bombe à U 235 pour amorcer la réaction
de fusion).
Mais laissons Israël à ses recherches,
et voyons comment l'Afrique du Sud est parvenue, elle aussi, à
devenir une puissance nucléaire. Car, aujourd'hui, la plupart
des analystes militaires pensent que la République sud-africaine
est capable de fabriquer des engins atomiques plus puissants que
la bombe d'Hiroshima.
C'est en 1961 qu'est créé le Centre sud-africain
de recherches nucléaires. Une de ses premières décisions
est d'acquérir un réacteur expérimental afin
que ses chercheurs puissent se familiariser avec cette nouvelle
source d'énergie. Celui-ci, dénommé SAFARI
I, est fourni par les Américains. Installé dans
les environs de Prétoria, il fonctionne à l'uranium
enrichi et entre en activité en 1964. Précision
importante, il est sous contrôle de l'Agence internationale
de l'énergie atomique, l'organisme chargé de faire
respecter les règles de non-prolifération (alors
que les Israéliens, eux, ont toujours refusé d'ouvrir
les portes de Dimona aux inspecteurs de l'AEIA).
Il en sera de même de la centrale nucléaire de Koeberg,
construite par la France et comprenant deux gros réacteurs
PWR (à eau légère et uranium faiblement enrichi).
Elle pourrait théoriquement fournir aux Sud-Africains plus
de 100 kilos de plutonium par an, mais, en vertu des conventions
passées avec l'AEIA, tout le combustible extrait des réacteurs
doit être retraité hors de l'Afrique du Sud.
Mais alors sur quoi se fondent les analystes militaires pour affirmer
que la République sud-africaine est en mesure de fabriquer
des armes atomiques? Sur un ensemble de faits et de données
dont voici les principales :
- L'Afrique du Sud possède de très importants gisements
d'uranium. Elle n'a donc pas de problème d'approvisionnement,
et le minerai qu'elle extrait échappe à tout contrôle.
- Une société d'Etat, I'UCOR (Uranium Enrichment
Corporation) a construit à Valindaba une usine pilote de
séparation isotopique (par la méthode de l'ultracentrifugation).
Une seconde usine, de grande capacité, est en voie d'achèvement.
L'Afrique du Sud dispose donc d'uranium enrichi. Or il suffit
de 52 kilos de métal enrichi à 94 % pour faire une
bombe A.
- De nombreux scientifiques sud-africains sont venus étudier
en France ; plusieurs atomistes ont effectué des stages
au centre nucléaire de Saclay.
- La coopération entre Prétoria et Tel Aviv, inaugurée
au lendemain de la guerre des six jours, a abouti en 1976 à
la signature d'un traité économique et scientifique.
Ce traité porte non seulement sur l'échange de matières
premières, mais aussi sur la communication de connaissances
techniques. Des liens privilégiés se sont tissés
entre le département de physique nucléaire de l'université
de Johannesburg et l'institut Weizmann.
- En collaboration avec Matra et Thomson, l'Afrique du Sud a mis
au point un missile capable d'emporter une ogive nucléaire.
Le "Cactus" (c'est le nom du missile) est devenu opérationnel
en 1969.
Bien sûr, tous ces éléments ne forment pas
une preuve, mais ils constituent au moins de solides présomptions.
On a cru un moment que l'Afrique du Sud s'était trahie
: en effet, le 22 septembre 1979, un satellite américain
VELA enregistrait un "flash" suspect dans la partie
australe du continent noir. Dans un premier temps, cet éclair
fut attribué à une explosion nucléaire dans
le désert de Kalahari ; mais les services de détection
américains abandonnèrent rapidement cette hypothèse
et invoquèrent un défaut du satellite.
Le cas du Pakistan est bien différent. Nul ne le soupçonne
de posséder la bombe, mais tout indique qu'il cherche à
l'avoir. En refusant de signer le traité de non-prolifération,
les Pakistanais avaient expliqué qu'un tel accord ne serait
acceptable que s'ils avaient la certitude que le "club des
cinq" ne deviendrait jamais le club des six. Disant cela,
ils pensaient naturellement à l'Inde, le grand voisin avec
lequel ils étaient périodiquement en conflit et
dont ils connaissaient les travaux en matière d'atome militaire.
LE PÈRE DE LA BOMBE PAKISTANAISE

Abdul Qadeer Khan avait quitté son pays pour se former
aux techniques occidentales.
Il y est revenu avec, en poche, les plans d'une usine d'enrichissement
identique à celle où il a travaillé en Hollande
(ci-dessous).

C'est après la guerre indo-pakistanaise
de 1971, guerre qui se solda par la défaite du Pakistan
et la perte de sa province orientale (devenue le Bangladesh),
que Karachi décida de s'engager résolument dans
la voie des armes nucléaires. Un plan fut échafaudé
qui comportait deux volets : à l'intérieur du pays,
mobilisation des meilleurs scientifiques et ingénieurs
pakistanais ; à l'extérieur, recherche des informations
et des équipements nécessaires à la réalisation
du projet.
C'est investi de cette mission de renseignement que le jeune Abdul
Qadeer Khan, ingénieur de son état, fut envoyé
en Europe. Il parvint à se faire engager à l'usine
d'enrichissement d'Almedo, aux Pays-Bas, une entreprise appartenant
à la firme URENCO. De 1972 à 1975, il eut tout le
loisir d'étudier la technique et le fonctionnement des
centrifugeuses, ainsi que la conception et l'organisation d'un
atelier de séparation isotopique. Rentré dans son
pays, il prit une part déterminante dans l'élaboration
et la construction, à Kahuta, de la première usine
d'enrichissement pakistanaise.
Les industries locales étant bien incapables de fournir
tous les éléments indispensables à une telle
réalisation, il fallut inévitablement se tourner
vers l'Occident. D'où une cascade d'"affaires"
ayant pour thème commun la violation du traité de
nonprolifération.
Ainsi, en 1976, la firme hollandaise Fysish Dynamisch Oderzoeckslaboratorium
fut poursuivie pour avoir vendu illégalement des instruments
de mesure destinés à l'usine de Kahuta. La même
année, une autre société hollandaise, spécialisée
dans les transmissions automobiles, la Van Doorne Transmissie,
fut accusée d'avoir exporté vers le Pakistan, malgré
les mises en gardes des autorités de La Haye, 6 500 tubes
en acier spécial. Ces tubes, bien entendu, étaient
eux aussi destinés à Kahuta; mais comme la "liste
noire" de l'AIEA ne les mentionnait pas expressément
parmi les produits interdits à l'exportation, la Van Doorne
fut en fin de compte acquittée (et la liste modifiée).
Ce n'était là toutefois que broutilles à
côté de l'affaire Migule. En 1977, un homme d'affaires
allemand du nom d'Albrecht Migule réussit à acheminer
au Pakistan non pas quelques compteurs ni quelques tubes, mais
un plein cargo de pièces détachées. Il s'agissait
tout bonnement d'une usine de conversion en kit ! Par conversion
on entend la transformation de l'uranium naturel en hexafluorure
d'uranium, préliminaire indispensable à toute opération
de séparation isotopique. Migule avait même fourni
en prime les techniciens qui montèrent l'installation à
Dera Ghazi. Il fut condamné à huit mois de prison
avec sursis et 10 000 dollars d'amende. Peine bien légère
quand on sait qu'il avait vendu l'ensemble pour 6 millions de
dollars !
Mais ce n'est pas tout. En 1980, Abdul Aziz Khan ainsi que deux
complices sont traduits devant la justice canadienne pour avoir
illégalement exporté au Pakistan des convertisseurs
de fréquence destinés à régler la
vitesse des centrifugeuses. En 1981, Sarfaz Mir et Albert Goldberg
sont poursuivis pour avoir tenté d'expédier à
Karachi, sous l'appellation d'"équipements d'alpinisme",
des tubes de zirconium spécialement conçus pour
être utilisés dans un réacteur nucléaire.
En 1983, Henk Slebos, encore un Hollandais, est condamné
pour avoir livré des composants électroniques à
l'usine de Kahuta.
Enfin, selon l'hebdomadaire allemand Stern, un navire de
la compagnie Global International Transport aurait embarqué,
le 10 août dernier, 880 kilos d'acier extra-dur à
destination du Pakistan. Le métal se présentait
sous la forme de cylindres dont le diamètre correspondait
exactement à celui de certaines pièces employées
dans les centrifugeuses de Kahuta. A l'origine, c'est une petite
entreprise londonienne, la Lizrose Ltd, qui avait commandé
cet acier spécial à Arbed Corporation, un grand
de la métallurgie allemande. Mais des agents occidentaux,
ayant eu vent de l'affaire, s'aperçurent que le directeur
de la Lizrose, un certain Inam Ullah Shah, était d'origine
pakistanaise. En conséquence, ils dissuadèrent Arbed
d'effectuer la livraison. Deux semaines plus tard, la firme allemande
enregistrait une nouvelle commande portant sur le même produit,
mais émanant cette fois d'un négociant de Cologne,
Mark Blok (lequel, soit dit en passant, est marié à
une Pakistanaise liée à Inam Shah). Comme Blok demandait
que l'acier lui fût livré dans ses entrepôts
de Cologne, Arbed, n'ayant pas besoin de licence d'importation,
honora la commande sans se poser trop de questions. Arrivée
à Cologne, la marchandise fut acheminée vers Hambourg
et chargée discrètement sur le navire de la Global.
Après analyse de tous ces trafics, on estime, dans les
milieux proches du gouvernement américain, que le Pakistan
possède actuellement une usine d'enrichissement équipée
de 14 000 centrifugeuses. Pour sa part, le Bulletin of the
Atomic Scientist pense que ce chiffre est exagéré,
et que la réalité est plus proche de 1000 que de
14 000 (mais il faut savoir que les centrifugeuses sont des appareils
fragiles et qu'il n'est pas rare que la moitié d'un parc
soit à l'arrêt pour réparations).
Quoi qu'il en soit, et même en se fondant sur l'estimation
la plus faible, on peut en déduire que le Pakistan a la
capacité de produire annuellement environ 21 kilos d'uranium
militaire (300 kilos dans la première hypothèse).
Or, nous l'avons vu, il suffit de 52 kilos d'uranium enrichi à
94 % pour faire une bombe. Et même, d'après l'AIEA,
en utilisant un réflecteur de neutrons relativement simple
(en entourant, par exemple, l'uranium d'une couché de graphite),
on peut fabriquer un engin "rustique" avec seulement
la moitié de ce poids. Il n'est donc pas extravagant de
penser qu'avec l'uranium enrichi accumulé ces dernières
années les Pakistanais sont en mesure de confectionner
plusieurs bombes A. A condition, évidemment, qu'ils possèdent
aussi le savoir-faire, c'est-à-dire un nombre suffisant
de physiciens, d'électroniciens, de métallurgistes,
de spécialistes des explosifs, etc. Car, dans ce domaine,
la matière grise compte autant que l'uranium.
Si l'on admet que le Pakistan a su former, chez lui ou à
l'étranger, les concepteurs et les exécutants nécessaires
à la réalisation de son projet - ce qui est tout
à fait vraisemblable -, alors sans doute est-il sur le
point de détenir quelques engins rudimentaires et ventrus,
analogues à la bombe d'Hiroshima. Ventrus parce que, en
l'absence d'expérimentation réelle, il est absolument
impossible de miniaturiser une charge nucléaire et d'être
assuré de son bon fonctionnement.
Mais, même rudimentaires, ces armes ne sont-elles pas si
terrifiantes que leur seule possession, par la menace qu'elle
fait peser sur l'adversaire, confère un avantage considérable
au pays qui les détient ? Ce n'est pas du tout certain,
car la menace peut se retourner contre celui qui la brandit. Ne
disposer que de quelques bombes A, c'est en effet s'exposer à
une frappe préventive destinée à éliminer
d'un coup tout l'arsenal atomique que l'on s'est constitué.
Il n'y a pas de vraie puissance nucléaire sans stratégie
adaptée. Or, cette stratégie repose entièrement
sur la capacité d'une seconde frappe, assurée soit
par une énorme réserve de projectiles nucléaires,
soit surtout par les indétectables sous-marins lanceurs
d'engins. Aujourd'hui, seuls les membres du "club des cinq"
sont à même de riposter à toute attaque préventive,
et c'est en cela précisément qu'un gouffre les sépare
des pays qui tentent de rivaliser avec eux.
A supposer que le Pakistan parvienne à se doter de quelques
bombes atomiques, l'Inde, son puissant voisin, ne tardera pas
à en faire autant. Au bout du compte, les deux pays se
retrouveront dans la même périlleuse situation, chacun
d'entre eux étant tenté de frapper le premier pour
annihiler la menace que l'autre fait peser sur lui. L'Inde, en
procédant à un unique essai, en 1974, a déjà
montré qu'elle n'était pas disposée à
se laisser intimider, mais qu'elle avait mieux à faire
que de fabriquer des bombes. Espérons que le Pakistan se
contentera lui aussi de manifester ses capacités sans chercher
à les concrétiser.
Sven Orteil,
Science & Vie n°847, avril 1988.
Retour sommaire